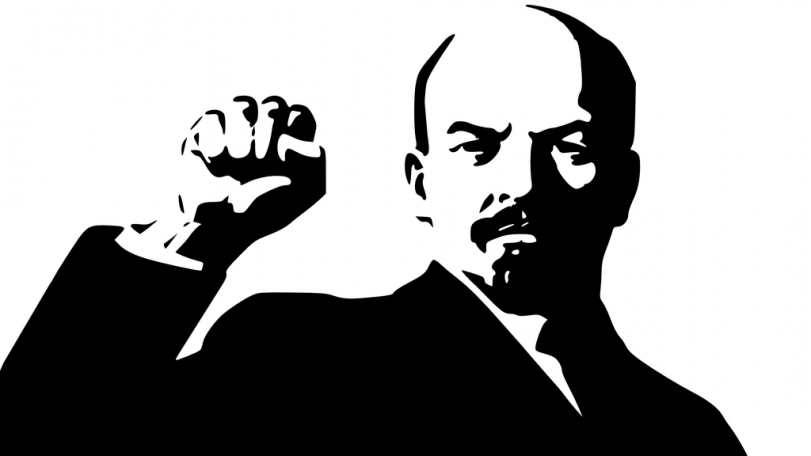Dès le 19e siècle, la Suisse, seul État libéral dans l’Europe des autocraties, accueillit des réfugiés politiques étrangers. Parmi eux un certain nombre de proscrits russes, qui exercèrent une indéniable influence sur le mouvement ouvrier de notre pays. Dans les années 1840-1860 s’y établirent Alexsandr Herzen et Ogarev, qui publièrent à Genève le journal Kolokol (La cloche), puis Michael Bakounine, le chantre de l’anarchisme, qui anima la fédération jurassienne de la première Internationale du mouvement ouvrier et décéda à Berne en 1876.
En 1883, G.V. Plekhanov fonda, également à Genève, le premier groupe marxiste russe: Libération du travail, qui put y publier et diffuser en Russie plusieurs des ouvrages des penseurs du socialisme dit scientifique (notamment les œuvres de Marx et Engels). Et ce ne fut certainement pas par hasard que c’est également en Suisse que se tinrent les premiers congrès (à Genève en 1866 et Lausanne en 1867) de L’Association internationale des travailleurs, créée en 1864 par Marx et Engels à Londres et baptisée par la suite Première Internationale du mouvement ouvrier.
Envoyé dès 1895 à Genève
Lénine (de son vrai nom Vladimir Illitch Oulianov), né en 1870, s’engagea dès sa prime jeunesse dans l’action révolutionnaire (après l’arrestation, en 1887, puis l’exécution de son frère aîné, qui avait participé à la préparation d’un complot contre le tsar Alexandre II). Il fut exilé pendant une année dans un petit village, pour avoir participé à une réunion d’étudiants à Kazan, avant de pouvoir reprendre des études et obtenir sa licence de droit à St-Petersburg. On comprend ainsi pourquoi il fut envoyé en 1895 déjà à Genève, pour prendre contact avec Plekhanov. Il vint encore à Genève en 1900, puis de 1903 à 1908, avec quelques mois d’interruption, pour y mener son action révolutionnaire et échapper à la police tsariste. En participant notamment à la fondation des journaux L’Iskra (L’étincelle), puis celle du Proletari et de Vpériod.
Lénine reviendra enfin en Suisse le 5 septembre 1914, après l’éclatement de la Première Guerre mondiale et un internement en Autriche, comme sujet d’une puissance ennemie. Sitôt arrivé à Berne, Lénine rencontra Robert Grimm1, grâce à l’intermédiaire duquel il avait pu se réfugier en Suisse et, au cours d’une longue discussion, exigea du leader socialiste suisse qu’il reprenne un combat révolutionnaire catégorique. Grimm répondit en évoquant les conditions spécifiques de la Suisse, mais sans convaincre Lénine. A partir de cette rencontre, où ressortirent les différences d’analyse et de tactique, la relation entre les deux hommes se détériora. L’historien Willi Gautschi estime qu’au-delà de ces divergences tactiques, «les raisons sont plus profondes et plutôt de nature psychologique […] Grimm ne voulait et ne pouvait se plier à l’autorité de Lénine».
L’implication de Lénine dans les débats de la gauche suisse
S’étant tout d’abord établi à Berne, alors qu’il aurait préféré Genève où il avait séjourné à plusieurs reprises avant de déménager en février 1916 à Zurich, il s’efforça de ne pas attirer l’attention des autorités suisses en menant une vie assez retirée, surtout axée sur la fréquentation des bibliothèques. C’est en Suisse qu’il écrivit quelques-uns de ses plus célèbres ouvrages (Un pas en avant, deux pas en arrière, Matérialisme et empiriocriticisme, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme).
Cependant, de manière assez discrète, il s’impliqua à plusieurs reprises dans les débats du Parti (PSS) et des Jeunesses socialistes suisses et bien entendu dans ceux du mouvement international, notamment par son active participation aux conférences de Zimmerwald et de Kienthal. C’est ainsi qu’il fit un exposé sur «les tâches de la gauche radicale (ou zimmerwaldienne) dans le PSS» au congrès de Zurich des 4 et 5 novembre 1916, dans lequel, après avoir critiqué les positions jugées opportunistes de Robert Grimm et d’Ernst Nobs, il esquisse un programme pour l’action révolutionnaire des socialistes suisses et développe des propositions précises en reliant la lutte contre la vie chère et contre les impôts indirects, à la lutte contre la guerre, menaçant même la Suisse, précise-t-il. En aucun cas, dit-il notamment, «ni en temps de guerre, ni en temps de paix les socialistes et leurs députés ne doivent voter les crédits militaires. Quels que soient d’ailleurs les beaux discours trompeurs sur la défense de la neutralité qu’on puisse faire pour justifier un pareil vote».
Quelques jours après (le 1er décembre 1916), dans une lettre à Arthur Schmidt, autre dirigeant socialiste, il suggère le lancement d’un référendum populaire pour la suppression du militarisme, lié à l’expropriation des grandes entreprises capitalistes et déclare que la Suisse a besoin d’un «gouvernement qui s’appuie non sur la bourgeoisie, mais sur la grande masse des ouvriers salariés et de la population la plus pauvre».
Puis, à la même époque, Lénine travaille à la rédaction de ses Thèses sur l’attitude de la Social-démocratie suisse envers la guerre où il déclare notamment:
– rejet absolu du mot d’ordre de défense du pays, tant du point de vue militaire qu’au point de vue politique, et dénonciation impitoyable du mensonge bourgeois qui se dissimule derrière ce mot d’ordre;
– le gouvernement suisse est l’intendant de la bourgeoisie suisse, entièrement dépendante du capitalisme financier international et intimement lié à la bourgeoisie impérialiste des grandes puissances;
– c’est pourquoi le fait que le gouvernement suisse pratique chaque jour davantage, et déjà depuis des dizaines d’années une politique réactionnaire et une politique secrète, le fait qu’il réduit et qu’il lèse les droits et les libertés démocratiques du peuple, qu’il rampe devant une clique militaire et sacrifie systématiquement et impudemment les intérêts des grandes masses de la population aux intérêts d’une infime oligarchie financière n’est pas un hasard, mais le résultat nécessaire de ces faits économiques;
– le prolétariat ne peut, en aucun cas, accorder confiance aux phrases sur la défense de la neutralité car, a) ces phrases émanent de la bourgeoisie suisse qui cherche ainsi à couvrir sa domination de classe et à garantir les intérêts du capital financier, b) l’expérience de divers pays neutres dans cette guerre a démontré que la défense armée de la neutralité peut du jour au lendemain conduire à la guerre par suite de l’enchaînement international des intérêts capitalistes;
– c’est pourquoi actuellement, en ce qui concerne la Suisse également, la «défense nationale» n’est qu’une phrase hypocrite, car, en réalité, il ne s’agit pas de défendre la démocratie, l’indépendance et les intérêts des grandes masses populaires, etc., mais au contraire de préparer le massacre des ouvriers et des petits paysans pour conserver les monopoles et les privilèges de la bourgeoisie pour renforcer la domination des capitalistes ainsi que la réaction politique.
L’influence de Lénine sur les jeunes socialistes suisses
Lénine, qui déploya, surtout dans les deux dernières années de son séjour en Suisse, une intense activité de contact et de propagande, aussi bien avec les cercles d’immigrés russes qu’avec les militants et les sympathisants socialistes de toute la Suisse, avait organisé avec la gauche zimmerwaldnienne une sorte de club, qu’on avait baptisé par plaisanterie, mais peut-être aussi pour détourner l’attention des autorités d’un foyer révolutionnaire, le Kegel-Klub (club de quilles). Celui-ci réunissait chaque semaine des militants de la gauche socialiste ou des anarchisants. Lénine louait ou critiquait les jeunes participants à ces réunions.
Ferdi Böhni, futur dirigeant syndical a décrit l’atmosphère de ces rencontres: «Lénine me donna l’impression d’un homme qui est en opposition constante avec tout ce qui existe et qu’il n’avait de cesse jusqu’à ce que tout soit sans-dessus-dessous et mit la tête à l’envers; et aussi qu’il mettait de manière permanente un petit groupe de gens en confrontation […] C’était un enseignant extraordinairement habile de la révolution. Jamais nous n’avions l’impression qu’il nous mettait sous pression. La manière dont il discutait avec nous était semblable au débat socratique […] Avec ses questions constantes il nous poussait dans les coins. Ce n’est que lorsque nous ne sentions plus sa présence que se mettait en marche la propre pensée critique […] Ce qui nous enthousiasmait chez Lénine était le fait qu’il nous prenait au sérieux, nous autres jeunes et même si nos opinions ne concordaient pas».
En hiver 1916-1917, les membres du Kegel-Klub distribuèrent un tract rédigé selon toute vraisemblance par Lénine et intitulé Contre les mensonges de la défense nationale. Un texte qui eut un grand retentissement, car il exigeait le refus des crédits militaires, la démobilisation, la fin de l’Union sacrée et de l’influence duGrütli2, la propagande révolutionnaire dans l’armée, le combat révolutionnaire de masse et la transformation socialiste de la Suisse.
Il faut cependant relever, comme le fait Willi Gautschi, qu’à plusieurs reprises, dans ses exposés et dans ses lettres, Lénine mentionne les libertés politiques de la Suisse qui, dit-il, en fait un des plus progressistes parmi les vieux Etats capitalistes. Ce qui impressionnait avant tout Lénine, souligne Gautschi, c’était la solution du problème des nationalités, avec la coexistence sur un pied d’égalité de populations parlant l’allemand, le français, l’italien et le romanche. Ce qui lui apparaissait comme un modèle. Gautschi fait encore remarquer que Lénine faisait montre d’étonnantes connaissances de détail sur la situation suisse.
Une influence objet de controverses
La question de savoir quels ont été les effets réels de la présence et de l’activité de Lénine sur la gauche suisse a souvent été l’objet de controverses. Curieusement, mais ce qui est explicable pour des raisons politiques, c’est la droite et la presse bourgeoise qui ont, pendant longtemps, imputé à Lénine l’agitation ouvrière, la radicalisation du Parti socialiste et même le déclenchement de la grève générale de 1918. Alors que l’historiographie social-démocrate et syndicaliste estimait au contraire que Lénine n’avait eu aucune influence sur le mouvement ouvrier suisse. La vérité est certainement à mi-chemin car si, à l’époque des privations pour les travailleurs et des scandaleux profits que les classes possédantes tiraient de la guerre, il n’y avait nul besoin de Lénine pour radicaliser la classe ouvrière suisse et le parti socialiste, il serait faux de nier l’influence qu’a pu exercer sa pensée et son action, surtout sur la jeunesse socialiste et même sur ses contradicteurs au sein du PSS.
En ce qui concerne la révolution d’Octobre, si la presse «bien-pensante» s’en prit immédiatement aux bolchéviks, «ces fanatiques, ces terroristes», la presse socialiste salua au début la révolution avec sympathie. «Très bien, Lénine. […] La gueuse faiblit. Tape dessus, brise lui les reins», devait écrire E.-Paul Graber, au lendemain de la prise du pouvoir par les bolchéviques; un homme qui devint pourtant peu de temps après un des plus virulents antibolchéviques du PSS.
Le retour en Russie en «wagon plombé»
Sitôt connue la chute du régime tsariste, les émigrés russes eurent la plus grande hâte de retourner au pays. Une entreprise qui n’était pas aisée, surtout pour les tenants de la gauche zimmerwaldienne, dont une grande partie se trouvaient en Suisse et qui avaient suffisamment fait connaître leurs sentiments en faveur d’un armistice immédiat avec le belligérant allemand et le renversement du capitalisme, pour que les alliés franco-anglais veuillent les mettre hors-jeu.
Ainsi Trotski, en exil à New-York, fut interné pendant plus d’un mois lors de son passage au Canada par les autorités militaires britanniques avant qu’il ne puisse regagner Petrograd. Pour Lénine et ses compagnons émigrés en Suisse, l’attente était intenable et ils cherchèrent tous les moyens possibles pour revenir en Russie, sans se faire interner par les puissances alliées. Lénine avait même envisagé, à l’aide d’un faux passeport que lui aurait fourni le bibliothécaire russe Karpinski, résidant à Genève, pour lui permettre de voyager à travers la France et l’Angleterre, en portant au besoin une perruque! En fin de compte, ce projet s’avéra trop aventureux, et malgré les réticences des émigrés non bolchéviques, il fut décidé de passer par le territoire allemand, donc l’Etat avec lequel la Russie était en guerre.
Pour Lénine et ses compagnons émigrés en Suisse, il fallut négocier avec le Gouvernement allemand par l’intermédiaire des leaders socialistes suisses Grimm et Platten, pour qu’ils puissent regagner la Russie en traversant l’Allemagne puis la Suède, dans un train aux wagons prétendument plombés, couverts par l’extraterritorialité. En contrepartie, les émigrés russes avaient dû s’engager à agir auprès du gouvernement provisoire pour qu’il libère un nombre égal de prisonniers austro-allemands. Parmi les participants au voyage, outre Lénine et son épouse Nadjeda Kroupskaia, se trouvait également leur amie (et pour d’aucuns la maîtresse de Lénine) Ines Armand, ainsi que Grigori Zinoviev – qui deviendra le premier secrétaire de l’Internationale communiste – et Karl Radek (tous les deux victimes des procès staliniens des années 1930). Et aussi, comme garant et responsable du bon déroulement du voyage et du respect des engagements pris avec les autorités allemandes, le Suisse Fritz Platten.
Ces conditions furent facilement accordées par les puissances centrales, persuadées que le retour des émigrés accélérerait la démoralisation de l’armée russe. C’est pourquoi ils furent aussitôt taxés d’agents allemands par la propagande des alliés anglo-français, qui tentèrent en vain de les faire arrêter par les autorités suédoises (pays resté neutre) lors du passage du convoi sur leur territoire.
La marche des bolcheviks vers le pouvoir
Le retour de Lénine, espéré et attendu par les uns, était peu apprécié par d’autres. Car avant même de quitter Zurich, en avril 1917, il avait exprimé des sentiments de «méfiance absolue » envers le gouvernement provisoire et son dirigeant Kerenski. Lénine demandait l’armement du prolétariat, des élections immédiates à la Douma de Petrograd; aucun rapprochement avec les autres partis».
Une intransigeance qui contrastait avec le comportement des leaders bolcheviques de Petrograd. L’analyse de Lénine, d’abord exprimée dans ses Lettres de loin (encore écrites à la veille de son départ de Suisse), puis dans Les thèses d’avril, rédigées dès son arrivée en Russie, ébauchait une tactique pour passer de la première à la deuxième phase de la révolution. C’est-à-dire: instaurer «la dictature révolutionnaire démocratique des ouvriers et des paysans» pour ouvrir la voie à la révolution socialiste mondiale». Des thèses qui furent considérées comme extrêmes si ce n’est démentes par les autres dirigeants politiques et même par ses amis politiques. Mais qui n’en reflétaient pas moins les sentiments d’un grand nombre d’organisations du parti bolchevique en province et des espoirs populaires.
Etant donné qu’à ce même moment le gouvernement provisoire avait assuré aux puissances alliées que la Russie continuerait la guerre à leurs côtés, une tempête de protestations s’éleva de toutes parts, y compris dans les milieux les plus «modérés», où l’on s’était convaincu de la nécessité de parvenir à un accord de paix avec l’Allemagne.
Le gouvernement Miljukov dut donc démissionner et aucune force politique ne semblait vouloir prendre la relève, sauf les bolcheviks, qui par la voix de Lénine, réclamèrent le pouvoir au premier congrès pan-russe des soviets malgré leur position très minoritaire. Ce qui fut considéré par le gouvernement provisoire comme une déclaration de guerre, d’autant plus que Trotski et ses partisans avaient rejoint les bolcheviks et que les manifestations se développaient. C’est pourquoi des mesures répressives furent engagées contre eux: Kamenev, Trotski, Lounatcharski, Kollontaï sont arrêtés. Lénine et Zinoviev parviennent à se réfugier en Finlande.
En août 1917, a lieu le putsch militaire de Kornilov, qui échoue, mais ébranle encore davantage l’autorité du gouvernement alors que celle des bolcheviks se renforce. Face aux tergiversations du comité central du parti bolchevique à engager l’action pour s’emparer du pouvoir, que Lénine, de plus en plus impatient, estimait être mûr à cueillir, il revint clandestinement à Petrograd afin de mettre tout le poids de son prestige en faveur de l’organisation d’une insurrection.
Bien que les controverses demeurassent vives au sein des dirigeants bolcheviques, les forces révolutionnaires passèrent à l’action le matin du 25 octobre (7 novembre selon le calendrier actuel) et occupèrent les points clés de Petrograd, arrêtant ou mettant en fuite les membres du gouvernement provisoire. L’après-midi, Lénine proclame le triomphe de la «Révolution des ouvriers et des paysans». Le soir, le deuxième congrès pan-russe des soviets décrète le transfert de tout le pouvoir aux soviets des ouvriers, paysans et soldats de toute la Russie. Le 26 octobre au soir, le congrès adopte les décrets sur la paix (proposant aux puissances centrales de mettre inconditionnellement fin à l’état de belligérance) et sur la terre (réforme agraire et distribution de terres aux paysans pauvres). Il approuve aussi la composition du Conseil des commissaires du peuple, nom donné au nouveau gouvernement révolutionnaire.
Qu’en penser aujourd’hui?
Aujourd’hui, après les péripéties, succès, déboires, échecs et finalement l’effondrement du régime né de la révolution d’Octobre 1917, on peut évidemment en tirer diverses conclusions. Pour les uns, auxquels on a assuré un grand battage médiatique et des excès d’honneur, cet avortement de la plus vaste tentative d’établir un nouveau régime social pour l’humanité prouverait l’inanité de vouloir remettre en cause «l’ordre naturel», voulant qu’une invisible main économique conduise l’humanité, certes par des chemins cahoteux mais inévitables, au moins mauvais des mondes: le capitalisme; plus volontiers présenté comme l’alliance de l’économie de marché et de la démocratie libérale.
Une conclusion que nous ne saurions partager, même si, bien sûr, on ne cherchera pas à idéaliser ou même à justifier la voie bolchevique pour parvenir aux changements nécessaires de l’ordre social. Mais aussi en ne considérant pas que la révolution d’Octobre 1917 en Russie et ceux qui en furent les partisans comme les générateurs des malheurs de l’humanité au 20e siècle. Lequel a d’abord connu, en 1914, l’affrontement des impérialismes capitalistes européens.
Et il n’est pas outrancier d’affirmer que la situation dans le monde serait sans doute pire à l’heure actuelle sans la répercussion énorme provoquée par la révolution d’Octobre: pour la lutte contre le colonialisme et le droit à l’autodétermination des peuples; par le défi que constitua le décollage économique de l’URSS dans les années 1930 pour les régimes capitalistes, qui furent obligés de faire des concessions sociales à la classe ouvrière et aux paysans pauvres.
Comme le disait André Fontaine: «Il n’y aurait pas eu de 1917, ni de guerre froide si la société capitaliste avait découvert la justice sociale avant d’y être contrainte par la pression des masses [et que] cette pression aidant, le monde dit occidental s’est considérablement transformé, s’éloignant de plus en plus de la description classique par Marx du capitalisme et par Lénine de l’impérialisme». A ce rôle d’aiguillon social et de libération des peuples ajoutons encore, selon l’évaluation du célèbre historien Eric Hobsbawn, que «sans la révolution d’Octobre, le monde serait probablement constitué [aujourd’hui] plutôt d’une série de variantes autoritaires et fascistes que d’un ensemble de démocraties libérales et parlementaires».
Comme on le voit, malgré son échec final et les tragédies humaines qui ont aussi jalonné son modèle de société, on ne saurait parler – a contrario d’une formule imprudente utilisée dans les années quatre-vingt qui parlait d’un bilan globalement positif – d’un bilan globalement négatif de la révolution soviétique d’Octobre 1917.
1 Ayant entrepris un apprentissage de typographe et un périple de compagnonnage dans plusieurs pays d’Europe, où il est gagné par le marxisme, il renonce à son métier pour se vouer totalement à l’action militante. Après être devenu secrétaire syndical de l’Union ouvrière de Bâle, Robert Grimm entame une véritable carrière politique à Berne comme rédacteur à la Berner Tagwacht et met sur pied une puissante organisation du Parti socialiste bernois, sur le modèle de la sociale démocratie allemande. Successivement élu aux parlements municipal et cantonal bernois, il le sera également au Conseil national en 1911. Mais Grimm, qui en a la carrure, aspire également à jouer un rôle international et y parvient grâce à son rassemblement des socialistes européens opposés à la guerre, ce qui aboutit aux fameuses conférences de Zimmerwald et de Kiental. Par la suite, il deviendra le leader de la grève générale de 1918, mais aussi celui qui sera l’un des principaux responsables de la politique de consensus du PSS avec la bourgeoisie (1881-1958).
2 Société ouvrière créée en 1838 (du nom de la prairie légendaire où se serait constituée la Suisse primitive) visant à exalter le sentiment patriotique de ses membres, en se proposant de parvenir à la libération et au mieux-être des travailleurs par l’éducation et l’observation de principes moraux. En 1901, elle adhéra collectivement au PSS et en constitua l’aile droite. Mais, en raison de l’évolution à gauche du parti, elle le quitta en 1915 et vota son auto dissolution en 1925.